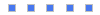

Je dois dire que j’attendais avec impatience de pouvoir visionner ce film après le choc et le plaisir que m’avait procuré Tetsuo 2 : Body Hammer. Dans un contexte différent, puisqu’il ne s’agit  plus de science-fiction, il confirme tout le bien que je pensais de lui avec cette histoire de jumeaux proche d’une histoire biblique (Moïse, Romulus et Remus) et située en dehors du temps. Mais attention, Gemini est à regarder jusqu’au bout, parce que bon nombre de spectateurs seront sans doute pris au dépourvu par la première demi-heure tout à fait incompréhensible. Puis petit à petit, tous les éléments nécessaires à la compréhension se découvrent, se révèlent, pour ne plus finalement laisser aucune zone d’ombre.
plus de science-fiction, il confirme tout le bien que je pensais de lui avec cette histoire de jumeaux proche d’une histoire biblique (Moïse, Romulus et Remus) et située en dehors du temps. Mais attention, Gemini est à regarder jusqu’au bout, parce que bon nombre de spectateurs seront sans doute pris au dépourvu par la première demi-heure tout à fait incompréhensible. Puis petit à petit, tous les éléments nécessaires à la compréhension se découvrent, se révèlent, pour ne plus finalement laisser aucune zone d’ombre.
Tsukamoto a donc fait le pari osé et ambitieux d’éclater en mille morceaux sa narration, passant sans prévenir d’un jumeau à l’autre, ou du présent au passé. Cela suggère donc une attention constante du début à la fin, mais ça vaut le coup…  Où l’on apprend donc qu’à la naissance de Yukio, un autre bébé partageait sa couche, qui n’était autre que son jumeau Sutekichi. Or, ce bébé possédait une marque à la cuisse droite ressemblant à un serpent, ce qui lui valut d’être balancé à la flotte par des parents peu scrupuleux. Récupéré par un homme vivant dans un bidonville entourant sa ville natale, il fut élevé dans la violence et la crasse. Il fit la connaissance de Rin et devint son mari. Mais à la suite d’évènements que je ne dévoilerai pas, Sutekichi est banni des taudis et donc séparé de Rin. Cette dernière part donc à la recherche de son mari et le retrouve en la personne de… Yukio !
Où l’on apprend donc qu’à la naissance de Yukio, un autre bébé partageait sa couche, qui n’était autre que son jumeau Sutekichi. Or, ce bébé possédait une marque à la cuisse droite ressemblant à un serpent, ce qui lui valut d’être balancé à la flotte par des parents peu scrupuleux. Récupéré par un homme vivant dans un bidonville entourant sa ville natale, il fut élevé dans la violence et la crasse. Il fit la connaissance de Rin et devint son mari. Mais à la suite d’évènements que je ne dévoilerai pas, Sutekichi est banni des taudis et donc séparé de Rin. Cette dernière part donc à la recherche de son mari et le retrouve en la personne de… Yukio !
Ce scénario est l’occasion de démontrer que l’on est toujours à égalité à la naissance, mais que c’est l’éducation qui forme l’Homme, et force est de constater que les bidonvilles provoquent sur les êtres humains des comportements violents. Occasion également de rappeler le peu de condescendance entre personnes aisées et pauvres (lorsque Yukio a le choix entre soigner une mère avec un bébé dans les bras venant des « slums » ou une personne respectable car riche, il n’hésite pas…), état de fait qui changera à la fin du film.
Mais cette critique ne serait pas complète si on omettait de dire un mot sur le style Tsukamoto : dès les premières images (des rats et des larves filmés en gros plan dans une couleur feu), on est fixé et rassuré sur la suite… Ce réalisateur jeune, talentueux et complètement barge a soigné sa mise en scène, son image (luminosité, couleur…) et n’a pas hésité à mélanger les genres, se sentant aussi à l’aise dans la maison respectable de Yukio que dans le bidonville de Sutekichi (à souligner les magnifiques costumes). Et puis, n‘oublions pas les incroyables moments de stress que procurent ce film : comment ne pas frémir lorsque la mère de Yukio voit une forme apparemment humaine en contre-jour dans sa demeure, forme qui s'avère être son fils maudit, tandis que de grands éclats de musique étouffés dans la seconde puis reprenant de plus belle illuminent la scène et glacent le sang du spectateur...
et n’a pas hésité à mélanger les genres, se sentant aussi à l’aise dans la maison respectable de Yukio que dans le bidonville de Sutekichi (à souligner les magnifiques costumes). Et puis, n‘oublions pas les incroyables moments de stress que procurent ce film : comment ne pas frémir lorsque la mère de Yukio voit une forme apparemment humaine en contre-jour dans sa demeure, forme qui s'avère être son fils maudit, tandis que de grands éclats de musique étouffés dans la seconde puis reprenant de plus belle illuminent la scène et glacent le sang du spectateur...
Avant d'évoquer ce Gemini, commençons d'abord par revenir sur le "cas" Tsukamoto. Cinéaste qui fascina aussi bien un Tarantino qu'un William Gibson dans les années 90, chouchou des festivals "alternatifs" en son temps, il suscita un véritable tir de barrage critique lors de la distribution française de son oeuvre en pleine vogue cinéphile de l'Asie. Il est vrai qu'en cherchant à "secouer" le spectateur mise en scène et montage n'évitaient pas toujours l'esbroufe et le brouillon. Témoin ce Tetsuo : The Iron Man inaugural dans lequel l'épate finissait par prendre le pas sur une belle énergie formelle. Mais Tsukamoto évitait heureusement souvent ce travers dans son plus rigoureux Tokyo Fist: énergie formelle, thématiques préfigurant Fight Club version roman et cinéma sans leur rébellion poseuse. Le reste de la filmographie se révèlera mi-figue mi-raisin, l'épate prenant souvent le pas sur la grâce. Mais d'autres cinéastes japonais plus "côtés" en leur temps dans l'hexagone avaient aussi leurs limites. Kurosawa Kiyoshi est certes un metteur en scène plus rigoureux mais son cinéma assène souvent ses références métaphysiques avec la légèreté d'une enclume. Eureka excepté, le cinéma d'Aoyama pue quant à lui les influences mal digérées et la prétention auteurisante. Et la filmographie de Miike a trop souvent besoin d'un monteur. Les attaques contre ce continuateur pas toujours inspiré des thématiques cyberpunk d'Ishii Sogo étaient donc aussi exagérées que certains portages au pinacle de l'époque. Epoque dont le cinéma de Tsukamoto était d'ailleurs synchrone sans toujours réussir à sublimer son air du temps. Gemini donc...
 Après un plan d'ouverture au caractère clippeux écoeurant, Gemini commence par se calmer sans pour autant réussir à véritablement convaincre. Tsukamoto commence en effet par essayer de se soumettre au cahier des charges d'un film japonais en costumes d'où un style de mise en scène un peu plus classique qu'à l'habitude, un personnage de médecin militaire qui n'est pas sans évoquer ceux vus chez Kurosawa et Imamura, meme si contrairement à eux il n'est pas encore pleinement pétri d'humanisme. Parmi les autres éléments de déjà vu, il y a les apparitions fantomatiques du jumeau et ce puits semblable à ceux qui ont abrité tant de fantomes du cinéma nippon. Ce début développe des thèmes intéréssants tels que la question du rapport du Japon à la science occidentale centrales dans le Japon de l'ère Meiji au travers des méthodes médicales importées par le héros ou l'idée d'une médecine socialement sélective qui fut dénoncée dans Barberousse. Sauf que Tsukamoto ne semble pas à l'aise pour mener une narration classique vu que les scènes d'intérieur n'arrivent pas à trouver leur bon rythme, ni durée classique, ni efficacité brute.
Après un plan d'ouverture au caractère clippeux écoeurant, Gemini commence par se calmer sans pour autant réussir à véritablement convaincre. Tsukamoto commence en effet par essayer de se soumettre au cahier des charges d'un film japonais en costumes d'où un style de mise en scène un peu plus classique qu'à l'habitude, un personnage de médecin militaire qui n'est pas sans évoquer ceux vus chez Kurosawa et Imamura, meme si contrairement à eux il n'est pas encore pleinement pétri d'humanisme. Parmi les autres éléments de déjà vu, il y a les apparitions fantomatiques du jumeau et ce puits semblable à ceux qui ont abrité tant de fantomes du cinéma nippon. Ce début développe des thèmes intéréssants tels que la question du rapport du Japon à la science occidentale centrales dans le Japon de l'ère Meiji au travers des méthodes médicales importées par le héros ou l'idée d'une médecine socialement sélective qui fut dénoncée dans Barberousse. Sauf que Tsukamoto ne semble pas à l'aise pour mener une narration classique vu que les scènes d'intérieur n'arrivent pas à trouver leur bon rythme, ni durée classique, ni efficacité brute.

Durant la seconde partie, le scénario devient plus convenu, débouchant sur un face à face dont le but est démontrer que ce sont les conditions sociales de naissance qui forgent l'individu, propos en partie vrai mais ne tenant pas compte de la part de libre arbitre qui se trouve en l'individu, de sa possibilté de se positionner contre cet héritage de naissance. Et comme s'il s'en rendait compte, le cinéaste complique un peu son propos sur la fin en montrant la duplicité comme pleinement assumée par l'individu. A ce stade, il faut mentionner les éléments rapprochant le film de Faux Semblants: dans les deux cas, la gémellité permet au personnage féminin de réfléchir sur ce qui l'attire ou la repousse dans les différentes facettes d'un homme -vu que dans les deux cas les jumeaux ne symbolisent rien d'autre que la scission d'un meme individu-. Cette seconde partie ne parvient pas à convaincre. Pourtant, son score plus classique est plus écoutable que les choeurs d'opéra pompiers de la première. Mais Tsukamoto décide de revenir à son style habituel. Et aussi à ses travers pubeux habituels avec ses scènes de taudis qu'on croirait échappées d'un clip de Duran Duran et ses caméras portées nuisant à la visibilité des scènes. Cette seconde partie souffre de plus du jeu très thétralisé des acteurs qui, s'il est parfois efficace dramatiquement, sombre par moments dans le grossier.
Au final, on a la démonstration avec cette adaptation de Rampo Edogawa moins réussie que celle d'un Masumura des limites du cinéaste. Même si cette fois il aura tenté en vain autre chose...

Deuxième film de commande du cinéaste après Hiroku, Gemini est l'adaptation d'un roman du japonais Rampo Edogawa (la transcription japonaise du nom d'Edgar Allan Poe en hommage à ce célèbre écrivain) basé sur la gémellité et teinté de fantastique. Même si le cinéaste avoue aimer son film, ses limites l'empêchent de trôner fièrement aux côtés de Tokyo Fist ou encore Tetsuo car le vrai problème de Tsukamoto est qu'il est génial lorsqu'il détient toutes les ficelles de son oeuvre. Bien qu'à la fois réalisateur, scénariste et directeur de la photo, Tsukamoto ne se libère jamais pleinement dans cette époque de l'ère Meiji, en costumes (modernes et traditionnels) et s'embrouille dans sa première partie. Les ellipses du début masquent une écriture aléatoire, comme une difficulté à poser son récit -calme en apparence- très loin de l'univers cyberpunk et définitivement urbain qu'il chérit tant. Gemini hésite donc trop souvent entre drame social (discrimination à l'encontre des "taudis") et pur conte fantastique (le double maléfique), alternant les séquences contemplatives (la séquence d'amour entre Sutekichi et Rin) avec d'autres moments plus brusques et teintés d'un profond sadisme.
Le cinéaste ne cache pas non plus sa préférence au double "mauvais" puisque Gemini prend son élan définitif à partir de l'apparition de Sutekichi, s'axant d'avantage sur son histoire -révolue et actuelle- plutôt que celle de Yukio, médecin sans problème mais manquant cruellement d'humanisme, notamment lors d'une séquence où ce dernier préfère secourir le maire du village plutôt qu'une jeune femme atteinte de la lèpre portant dans ses bras un enfant en sal état. Tsukamoto rédige alors un semblant de punition pour ce médecin "modèle" et l'enferme dans un puits pendant une grosse demie heure, l'humiliant tant qu'est plus. En revanche, la surprise vient du côté de la mise en scène, loin du style sal et granuleux d'un Bullet Ballet ou de l'hystérie assourdissante d'un Tetsuo, Tsukamoto privilégie les superbes éclairages et lumières du crépuscule pour asseoir un climat curieux, entre sérénité formelle et horreur fondamentale.