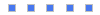

| Ordell Robbie | 3 | Pas visuel en avant et passages annoçant la verve de Shara. |
| Xavier Chanoine | 3.5 | Un second film confirmant Kawase au rang de cinéaste précieuse |
Hotaru est le second long métrage de Kawase Naomi. C’est son autre enfant, comme elle l’appelle, et il aura fallu dix ans avant qu’elle ne le présente aux festivals et au monde entier. Pas peu fière, la réalisatrice, forte d’une reconnaissance internationale méritée pour l’ensemble de son œuvre, à la fois humaine et pleine de chaleur bouleversante. Une fois encore, Kawase filme la région de Nara, sa région, avec toute la sensibilité qu’on lui connait depuis Suzaku, ses courts métrages et documentaires autobiographiques. On y retrouve la pureté quasi zen des contrées mais aussi l’énergie de la ville où la cinéaste pose sa caméra pour des moments aussi intenses qu’alertes : de la ville, on verra essentiellement un établissement de strip-tease, lieu de travail de la belle et tourmentée Ayako, mais aussi une place où la « grande sœur » de cette dernière et meneuse de danse s’adonnera à une démonstration de strip hallucinée au souffle de liberté assez unique. Hotaru effleure d’ailleurs très souvent le spectateur de son vent de liberté, du mode de vie des protagonistes au jour le jour, à mi-chemin entre conte fantastique et récit autobiographique. Pourtant, Hotaru est une film d’une simplicité presque trop évidente sur le papier, au risque de tomber dans les travers de la cinéaste consistant à filmer pour filmer, mais heureusement l’œuvre est soutenue par un fil conducteur solide, tout aussi simple, mettant en avant les difficultés de la jeune femme à tirer un trait sur quelque chose de pas tout à fait perceptible, mais dans tous les cas palpable grâce à une mise en scène souvent proche des corps tourmentés, presque malades à l’image de son documentaire réalisé deux ans plus tard, La danse des souvenirs.
Simplement, en dehors de ses teintes ternes et ses éclairages datés au sein de l’établissement de strip-tease, Hotaru délivre pourtant de temps à autres des séquences au vrai pouvoir hypnotique : en deux mots, l’introduction et la conclusion sont formellement inouïes, les séquences baignées dans un noir profond exacerbent la rougeur et l’incandescence extrême d’une pluie de cendres encore chaudes versées dans le ciel et ainsi exposées aux spectateurs venus assister au festival du feu de la région, une tradition. Des images non sans rappeler un des plus grands plasticiens du cinéma japonais, Oguri Kohei , où le naturel prend des allures d’œuvre poétique à part entière simplement par la souplesse du filmage qui la représente, son originalité mais également sa singularité. Car l’œuvre de Kawase, au sens large, ne représente rien de bien connu : la cinéaste filme la vie, les gens, la mort, la naissance –au sens physique et spirituel, dans un pur souci de raconter quelque chose, une expérience, une douleur, un état d’esprit. Si l’on devait encore en douter, Hotaru est du genre mélodramatique, mais on ne parle pas ici de films qui font du lacrymal pour du lacrymal à l’image de ces dizaines et dizaines de mélodrames que l’on voit fleurir chaque année au cinéma. L’œuvre de Kawase est l’une des rares dans ce paysage sclérosé à proposer un contenu presque vital et viscéral à la fois. Certes ici la cinéaste offre ça et là des moments d’une puissance inouïe, comme le bain festif dans la fontaine publique, mais ces rares séquences émaillent un ensemble moins empli de grâce qu’à l’habitude, là aussi à l’image de Nanayo et son manque de matière malgré des éclairs de géni redoutables d’efficacité. Des Hotaru, Kawase Naomi pourrait en faire des dizaines, il y aurait à n’en pas douter ce même sens du cadre offert par une caméra tour à tour tourmentée comme énergique (à l’image de ses héros), cette faculté à capter la puissance spirituelle de la nature (les nappes de vent sur les herbes vertes) pour en faire un outil cinématographique à part entière. Kawase Naomi est l’une des rares cinéastes à capter ce qui n’est pas, paradoxalement, perceptible, ce qu’elle rabâche très régulièrement à chaque nouveau film attendu comme un diamant précieux que l’on rêve de tailler soi-même : on comprend son cinéma selon nos affinités. Inutile de dire que l’on se l’approprie également à notre manière.


